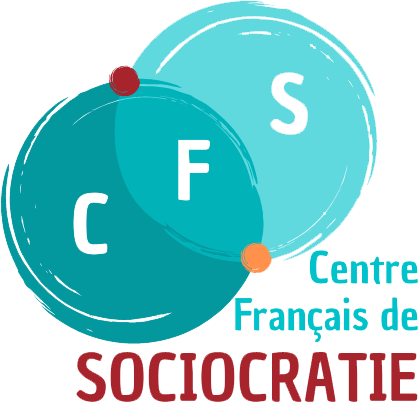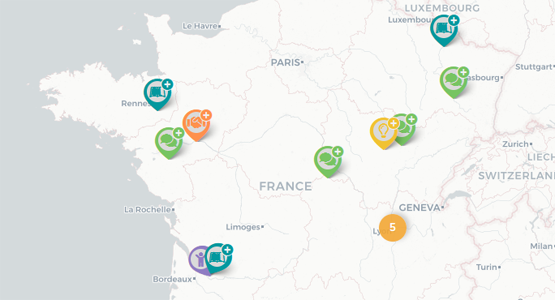La règle du consentement en sociocratie nous invite à conjuguer cadre et liberté dans les groupes. Cela suppose de formuler de manière explicite ce dont nous avons besoin pour nous sentir en sécurité et être dans des conditions propices à la réalisation de l’objectif commun. On part donc de nos subjectivités pour (tenter de) construire un cadre commun. Voici un exemple de ce processus dans le contexte de la préparation d’un événement public.
L’Agora de la Gouvernance Partagée est un événement public prévu à Versailles du 24 au 27 avril 2025. Formateur agréé par le Centre Français de Sociocratie et membre actif de la branche francophone de Sociocracy For All, j’ai été individuellement invité par son organisateur à y participer en tant qu’intervenant (ainsi que Pierre Tavernier). Suite à une réunion en visioconférence, j’avais accepté cette invitation, ce dernier ayant bien accueilli ma proposition d’élaborer un cadre de sécurité qui me permettrait d’y participer sereinement.
Je sais que l’Université du Nous (auprès desquels il s’était formé) préconise aux groupes de rédiger leur cadre de sécurité. Plus largement, dans les associations, on parle souvent d’une « charte » dans laquelle le collectif formule ses valeurs et des règles de fonctionnement. Toutefois, les aspects relationnels y sont souvent peu décrits, ou bien en des termes vagues (bienveillance, respect…) dont on suppose qu’ils ont une signification partagée. Au moins constituent-ils la base d’un cadre de référence qui peut permettre de se parler en cas de tensions. Cela peut suffire, notamment dans des groupes de petite taille et relativement homogènes ; ou encore lorsque l’activité collective est fortement dirigée (par exemple lors d’une formation). Mais le risque existe que le conflit finisse par se cristalliser autour de l’interprétation à faire de cette charte, alors des mécanismes d’exclusion risquent de se mettre en place, car c’est l’identité collective qui est en question, le sentiment d’appartenance de ses membres, et donc possiblement la pérennité du groupe lui-même.
À travers mon expérience comme co-fondateur d’une école démocratique (La Croisée des Chemins, 2014-2020), je sais que la liberté ne peut s’épanouir que dans un contexte de forte sécurité psychologique ; et que cette sécurité ne peut s’appuyer seulement sur la bonne volonté des membres d’un groupe : elle requiert un cadre clair et consistant qui tienne compte des besoins de chacun-e. Comment réinventer la notion de cadre, au delà du schéma classique de l’autorité exercée par la contrainte ? Au fil des années et des conflits (entre enfants, entre adultes), nous avons affiné peu à peu notre compétence politique à élaborer et appliquer nos propres règles – ce qui est un apprentissage important pour vivre ensemble de façon sociocratique.
L’un de nos apprentissages majeurs fut celui de ne pas édicter de prescriptions en ce qui concerne la manière d »être en relation les uns avec les autres : ni en terme moraux (« il faut être gentil avec ses camarades »), ni en terme de compétences attendues (« s’exprimer sans jugement »). En effet, ce type de règles conduit à la culpabilisation (de soi ou d’autrui), ce qui est contre-productif. Un cadre de sécurité pour un groupe me semble même source d’une potentielle violence psychologique dès lors qu’il dépasse la question des intentions communes et des limites auxquelles ses membres peuvent consentir – et qu’il se mêle de leur « ego », c’est-à-dire de leur personnalité (pensées, émotions, désirs, croyances…).
Un autre apprentissage majeur concerne le fait qu’il existe toujours un cadre dans un groupe, le plus souvent implicite et fondé sur des dynamiques de pouvoir informelles : Qui a une parole plus légitime ? Qui a plus d’amis, d’alliés ? Comment se comportent la majorité, les figures d’autorité ? Quelles sont les normes sociales habituelles dans notre milieu (les « bonnes manières ») ? Il s’agit de réalités que l’on ne peut pas changer d’un coup de baguette magique. Mais on peut les réguler par des règles équitables et applicables, auxquelles le groupe sera prêt à donner une légitimité supérieure. Formuler un cadre explicite et consenti suppose donc de venir questionner des accords tacites que chacun-e imagine évidents mais qui ne le sont souvent pas pour tout le monde. C’est déjà en soi une transformation de la culture collective, dans un sens plus inclusif, ouvert et transparent.
Pour revenir à l’Agora de la Gouvernance Partagée : avec cette conscience de l’importance de la qualité du cadre pour n’importe quel collectif humain, j’ai réfléchi à ce que seraient pour moi les accords fondamentaux nécessaires à une expérience de sécurité et de liberté au service des intentions annoncées de ce rassemblement. J’ai aussi tenu compte de sa durée, du nombre et de la diversité des participants, du caractère en partie exploratoire et auto-organisé de son programme, de l’ouverture au public, de la rivalité probable et des jeux de pouvoir existants entre intervenants promoteurs d’une pratique identifiée…
J’ai donc rédigé un texte, que j’ai d’abord amendé suite à des commentaires et suggestions de l’organisateur de l’événement, mais notre discussion n’a pas conduit à un accord. J’ai décidé donc de publier cette proposition à titre d’exemple méthodologique, de source d’inspiration et de discussion, dans le cadre d’une licence Creative Commons (Attribution, Partage dans les mêmes conditions).
J’espère qu’il vous fera réfléchir, notamment si vous êtes en désaccord avec certains points ! Dans ce cas, comment pourriez-vous formuler un accord qui vous convienne ?
Thomas Marshall